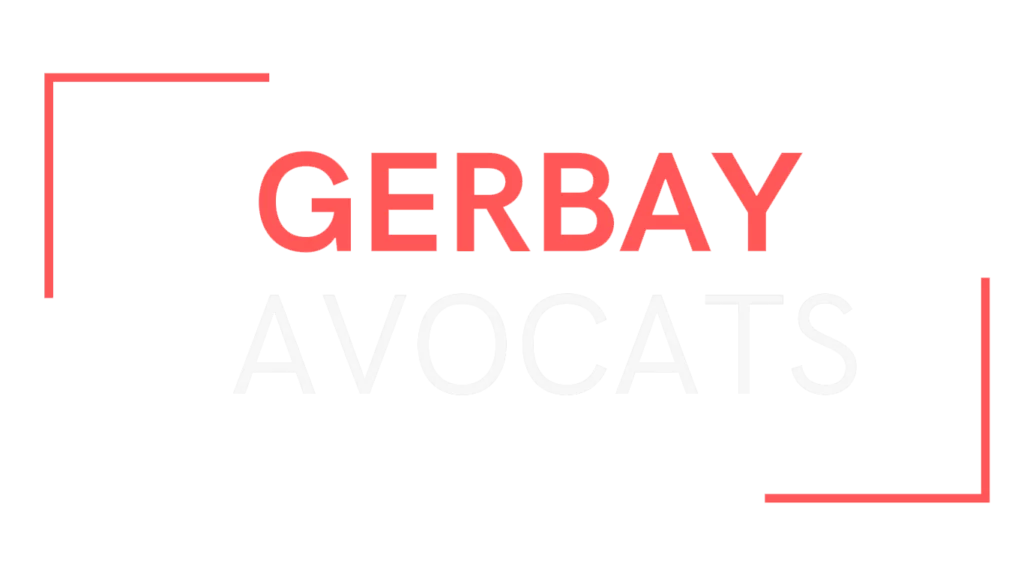Philippe Gerbay, avoué honoraire à la cour maître de conférences à la faculté de droit, sciences économique et politique de l’université de Bourgogne (émérite)
La confusion entre appel nul ou appel irrecevable est très dommageable : le premier peut être réitéré, ce qui n’est pas le cas du second. Pourtant, en jurisprudence, on constate un certain relâchement. Il est essentiel de recadrer les notions.
Les irrégularités de fond et les fins de non-recevoir affectant l’acte d’appel étaient traitées, il fût un temps, sur le même plan, et rien ne semblait les différencier quant à leurs effets.
Il faut malgré tout en revenir aux fondamentaux. Le Code de procédure civile est clair, s’agissant par exemple d’une société ayant perdu la personnalité morale à la suite d’une fusion-absorption : la déclaration d’appel formée par la société absorbée préalablement est nulle pour « défaut de capacité d’ester en justice » (CPC, art. 117, al. 2).
La fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir selon l’article 122 du Code de procédure civile. Celui-ci, à titre d’exemple, se réfère au défaut de qualité, défaut d’intérêt, à la prescription ou à la chose jugée. Cette liste n’est pas limitative mais on peut observer que le défaut de capacité n’est évidemment pas cité. Et pour cause, le Code de procédure civile traite des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir au titre V relatif aux moyens de défense dans deux chapitres distincts. L’architecture du code, si bien conçue ab initio,doit être scrupuleusement respectée.
Cela dit, pourquoi s’embarrasser de subtilités procédurales puisque la nullité ou l’irrecevabilité de l’appel ont la même conséquence : priver l’appelant de son droit d’action ? Cela explique sans doute que l’on trouve trace en jurisprudence et plus rarement en doctrine d’un certain laxisme dans l’emploi des mots.
Mais, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 sur la prescription et le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 sur la procédure d’appel ont révélé que ces deux notions ont des trajectoires différentes.
Dès 2009, des esprits clairvoyants se sont interrogés sur le point de savoir si la décision prononçant la nullité de l’acte d’appel n’interrompait pas le délai d’appel[1]. Le délai de procédure, et notamment celui d’appel, est un délai de forclusion. L’article 2241, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, a prévu une interruption du délai de prescription ou de forclusion lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. La Cour de cassation a consacré cette thèse en 2014[2]. Bien plus, alors que la loi évoquait « un vice de procédure », la Cour de cassation a entendu cette notion au sens large, y incluant non seulement les vices de forme mais également les irrégularités de fond. Cette assimilation, parfois critiquée, serait la conséquence d’un fâcheux « lapsus législatif »[3].
La différence est donc actée selon que la déclaration d’appel est nulle ou irrecevable.
La première est réitérable après la décision prononçant la nullité, le délai d’appel est alors interrompu par ladite décision. La seconde ne l’est pas dès lors que l’irrecevabilité a été déclarée et ce depuis le décret du 6 mai 2017[4].
De surcroît, la décision prononçant la nullité a un effet rétroactif tandis que la décision prononçant l’irrecevabilité de la déclaration d’appel a un effet déclaratif, ce qui n’est pas nécessairement sans incidence procédurale.
Respectons dès lors la qualification adéquate à une déclaration d’appel dont il est prétendu qu’elle est irrégulière en raison notamment d’un défaut de capacité d’ester en justice. C’est à ce prix que l’on évitera des contentieux collatéraux et parasites.
Récemment encore, la cour d’appel de Versailles[5] a, dans un cas où l’appel avait été formé par une société absorbée, déclaré l’appel « irrecevable » pour défaut de « qualité à agir » tout en visant l’article 117 du Code de procédure civile… C’est un lourd tribut payé à l’erreur procédurale que de confondre la qualité pour agir [6] et la capacité à ester en justice. L’appelant, en n’orientant pas le débat sur la bonne qualification, et la cour, en ne requalifiant pas la demande de l’intimé, a coupé court à toute possibilité de réitération de l’acte d’appel.
[1] V. par ex., J. Junillon, « Une déclaration d’appel irrégulière peut-elle interrompre le délai d’appel ? », Procédures mars 2009, prat. 2.
[2] Cass. 1re civ., 16 oct. 2014, n° 13-22.088.
[3] C. Brenner et H. Lecuyer, « La réforme de la prescription », JCP G, 2009, 1197, n° 24.
[4] CPC, art. 916, qui vise non seulement l’irrecevabilité de l’appel mais aussi sa caducité, traduction d’un principe d’unicité de l’appel (JCP G 2019, 56, note P. Gerbay). Le pouvoir réglementaire ne pouvait étendre la non-réitération à l’hypothèse d’un acte d’appel dont la nullité a été prononcée, cette question relevant du seul domaine législatif.
[5] CA Versailles, ch. soc., 8 janv. 2025, n° 24/01493.
[6] Sur la qualité pour agir, v. not. G. Bolard, « Qualité ou intérêt à agir ? » in Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, 2010, Dalloz, p. 597 et s. ; H. Motulsky, relate l’auteur, souhaitait l’abandon de la qualité pour agir, simple aspect particulier de l’intérêt à agir.