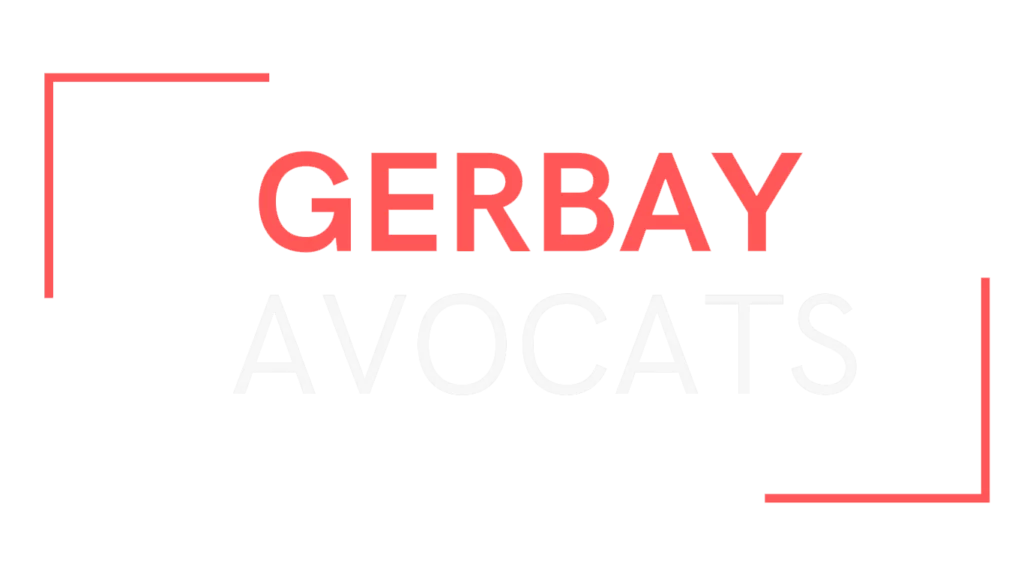Cass. 2e civ., 28 nov. 2024, n° 22-16.664, B : JurisData n° 2024-022361
Solution. – L’absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites n’est assortie d’aucune sanction. Le juge a l’obligation d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats clairement identifiées dans les conclusions prises au soutien des prétentions.
Impact. – L’assouplissement bienvenu dans l’interprétation des textes régissant la procédure d’appel, sous l’influence de la Cour EDH qui sanctionne tout formalisme excessif, ne devrait pas être sans lendemain. Au-delà, la cour d’appel, et par ricochet la Cour de cassation, devraient être déchargées du contentieux lié à la structure des conclusions si le conseiller de la mise en état exerçait ses pouvoirs.
1. Articulation pièces/prétentions et la Cour de cassation
Les exigences imposées par le Code de procédure civile sont interprétées avec doigté par la Cour de cassation.
A. – L’exigence textuelle
Le sort des pièces à l’appui des prétentions a été réglementé au fil du temps par la Chancellerie. En 1998 (D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, modifiant le code de l’organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile), à la suite du rapport Coulon (Réflexions et propositions sur la procédure : Doc. fr., 1997, p. 76 et 104), fut institué le bordereau des pièces annexé aux écritures. En 2009 (D. n° 2009-1524, 9 déc. 2009, relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile : JCP G 2010, act. 3, Aperçu rapide H. Croze), à la suite du rapport Magendie (Célérité et qualité de la justice devant la cour d’appel : Doc. fr., 2008, p. 66), il fut ajouté que les conclusions doivent inclure « l’indication pour chaque prétention, des pièces invoquées ». Pour parachever l’édifice en 2017 (D. n° 2017-891, 6 mai 2017, relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile : JCP G 2017, doctr. 659, Étude S. Amrani-Mekki) il a été institué à l’article 954 du CPC l’exigence d’une numérotation des pièces. La cohérence implique que des numéros soient inscrits dans le corps des écritures au gré des prétentions et moyens invoqués et que ces numéros renvoient à la numérotation du bordereau descriptif des pièces.
Toute nouvelle pièce, si elle est estimée déterminante, devrait impliquer la mise à jour de la numérotation dans le bordereau et être insérée dans le corps des conclusions. Cela suppose donc la notification de nouvelles écritures. C’est la théorie qui s’accorde avec le respect du contradictoire et le souci de guider utilement la cour. La réalité du terrain est tout autre. Parfois, la numérotation est anarchique résultant de la reprise du bordereau établi en première instance. D’autres fois, la nécessité de déposer des conclusions récapitulatives se traduit par un empilement des moyens dans les écritures sans égard avec la logique d’un nouveau bordereau. D’autres fois encore, la numérotation est purement et simplement absente dans le corps des conclusions. C’est à cet écueil que s’est heurtée la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 23 févr. 2022, n° 18/07269) : aucun renvoi dans douze pages de conclusions alors que 95 pièces figuraient au bordereau. On est loin de l’excellence voulue par les textes. Ab irato, la cour déboute l’appelant faute de pouvoir vérifier les calculs de celui-ci qui sollicitait la condamnation de l’adversaire au paiement de certaines sommes à la sortie d’une indivision. La Cour de cassation, ne l’entend pourtant pas de cette oreille…
B. – L’exigence jurisprudentielle
La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté (Procédures 2025, comm. 2, obs. S. Amrani-Mekki) ne veut pas s’enferrer dans un formalisme excessif faute de sanction spécifique prévue à l’article 954 du CPC. L’absence de renvoi dans les écritures aux pièces produites « clairement identifiées » ne dispense pas le juge de les examiner.
Restera à préciser le contour de cette notion appréciée in concreto par la Cour de cassation (Dalloz actualité, 8 janv. 2025, obs. R. Laffly). La Cour de cassation n’ouvre pas la porte à des communications anarchiques et à des pièces remises en vrac, traduction d’une certaine désinvolture. Cependant la cour d’appel devra désormais, pour débouter l’appelant, motiver sa décision en expliquant en quoi les pièces produites ne sont pas « clairement identifiées ». Si dans le corps des conclusions il est clairement renvoyé à une pièce versée aux débats, l’absence de numérotation ne sera pas rédhibitoire. L’arrêt commenté, rendu au double visa de l’article 6, § 1 de la Convention EDH et de l’article 954 du CPC, s’inscrit dans le prolongement de décisions de la même veine. Ainsi, l’absence d’un paragraphe intitulé « discussion » n’est pas sanctionnée si les écritures sont « claire(s) » et « lisible(s) » (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-12.736 : JurisData n° 2022-014236. – V. N. Gerbay, Le formalisme des conclusions : pourquoi pas ? Le ritualisme : non ! : JCP G 2022, 1193. – V. également, Cass. 2e civ., 29 juin 2023, n° 22-14.432 : JurisData n° 2023-010435 ; Procédures 2023, comm. 264, obs. S. Amrani-Mekki ; JCP G 2023, 1059, note N. Fricero). Dans la première espèce, les conclusions distinguaient dans une partie « en droit » les prétentions ainsi que les moyens soulevés en appel à l’appui de celles-ci. Il a également été jugé qu’une cour d’appel ne peut s’emparer d’une erreur matérielle affectant l’entête des écritures pour confirmer le jugement (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 22-16.223 : JurisData n° 2024-017013 ; Procédures 2024, comm. 266, obs. S. Amrani-Mekki ; JCP G 2024, doctr. 1434, n° 2, obs. L. Mayer). Cet arrêt est d’ailleurs remarquable en ce qu’il réserve deux articulats (5 et 6) aux exigences liées à l’application de l’article 6, § 1 de la Convention EDH consacrant l’existence d’un accès concret et effectif à la juridiction. Un passage pédagogique à ne pas ignorer. Encore tout récemment, la France a été condamnée pour formalisme excessif, notamment pour avoir refusé d’examiner le pourvoi en cassation en raison d’une omission matérielle laquelle était pourtant susceptible d’être régularisée et l’avait été (CEDH, 21 nov. 2024, n° 78664/17, Justine c/ France : JurisData n° 2024-022792 ; JCP G 2024, act. 1463, obs. L. Milano).
L’absence de sanction prévue à l’article 954 du CPC est l’élément déterminant et cela ouvre la porte à de nouvelles perspectives. En effet, le décret du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile (D. n° 2023-1391, 29 déc. 2023 : JCP G 2024, prat. 209, E. Vajou) impose désormais à l’appelant d’indiquer, dans le dispositif de ses conclusions, s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement. Cependant, contrairement à ce qui était prévu dans l’avant-projet de décret, cette formalité est dépourvue de toute sanction. Cela condamne logiquement la jurisprudence très critiquée de la Cour de cassation qui vouait aux gémonies l’appelant ayant omis, fût-ce par pure erreur matérielle, de solliciter l’annulation ou l’infirmation dans le dispositif de ses écritures (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626 : JurisData n° 2020-013427 ; JCP G 2020, 1281, note N. Cayrol). Cette exigence purement formelle et extra legem, alors que les conclusions sont parfaitement intelligibles ne s’accordait pas avec la jurisprudence de la Cour européenne. Elle résultait d’une corrélation discutable entre les articles 542, 908 et 954 du CPC.
La Cour de cassation (chambre commerciale) juge, de manière paradoxale d’ailleurs, que la cour d’appel n’a aucune obligation de préciser dans le dispositif de sa décision qu’elle réforme, annule ou confirme le jugement entrepris (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 22-14.250 : JurisData n° 2024-023001 ; Dalloz actualité, 18 déc. 2024, obs. crit. M. Barba, qui évoque une « incohérence mâtinée d’injustice »). Comprenne qui pourra ! In fine, tout du moins si l’on s’en tient à l’article 954 du CPC, seule l’obligation d’énoncer les prétentions au dispositif est assortie d’une sanction : la prétention omise ne pourra pas être prise en compte par la cour d’appel (CPC, art. 954, al. 3).
Au-delà, toutes ces questions ne devraient-elles pas être solutionnées en amont ?
2. Articulations pièces/prétentions et la cour d’appel
Dans le cadre du circuit classique, une phase de mise en état des causes (A) précède l’audience au fond (B).
A. – L’effacement du rôle du conseiller de la mise en état
Le conseiller de la mise en état a été mis en place en 1965 pour être la « cheville ouvrière » de la procédure d’appel (H. Motulsky, La réforme du code de procédure civile par le décret du 13 octobre 1965 et les principes directeurs du procès : JCP G 1966, 1, 1996). Son rôle est de déblayer tout contentieux parallèle en tranchant préalablement celui-ci avant que la cour ne s’empare du fond (M. Douchy-Oudot, La scission des phases de l’instance : la mise en état, mél. G. Wiederkehr : Dalloz, 2009, p. 234). Dans notre problématique, il faut se tourner vers l’article 913-1 du CPC lequel figure, depuis le décret du 29 décembre 2023 (D. n° 2023-1391, 29 déc. 2023, préc.), dans un sous-paragraphe spécifique à la procédure d’appel définissant les attributions du conseiller de la mise en état : « Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 ». Dans le mois suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces (sans sanction !) le conseiller de la mise en état « examine » l’affaire. Tout est écrit : le conseiller de la mise en état peut vérifier que les écritures et les pièces associées sont lisibles, intelligibles et conformes à la lettre et à l’esprit de l’article 954 du CPC. De manière générale, il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces (CPC, art. 913-1, al. 2). Il peut adresser des injonctions aux avocats (CPC, art. 913-1 in fine). D’aucuns prédisaient, à l’époque de son instauration, que la communication électronique favoriserait une mise en état « intellectuelle ». La réalité est cruelle : c’est une mise en état purement robotisée qui s’est installée. Le conseiller de la mise en état apparaît à bien des égards comme un « père fouettard » chargé de distribuer caducités ou irrecevabilités. Ainsi, en l’état de la jurisprudence du 17 septembre 2020 (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626, préc.), si le mot infirmation a été oublié, par pure omission matérielle dans le dispositif des conclusions, la caducité de la déclaration d’appel est immédiatement encourue sans dialogue possible au nom de la bonne administration de la justice (!). Cela accrédite l’idée, plutôt minoritaire, que les chausse-trappes procédurales sont exploitées au mieux pour alléger le rôle des cours d’appel. Il appartient, il est vrai, aux avocats d’exceller dans la présentation de leurs écritures, avec l’appui actif du postulant s’il y a lieu. S’il est rétorqué que les moyens alloués à la justice ne permettent pas d’appliquer les textes, alors il faut repenser le rôle du conseiller de la mise en état… En l’état, si l’article 913-1 du CPC était appliqué, ce qui n’est généralement pas le cas, cela allégerait le travail de la cour statuant au fond et permettrait de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne.
B. – L’alourdissement du rôle de la cour
Pour sanctionner la France, la Cour européenne retient notamment que la cause d’irrecevabilité a été « soulevée d’office » et « à un stade avancé de la procédure » alors que le droit interne n’imposait pas de relever d’office un tel moyen. Pour la Cour européenne, « la règle procédurale a donc été appliquée comme une barrière empêchant de trancher une affaire pourtant prête à être jugée » (CEDH, 21 nov. 2024, n° 78664/17, Justine c/ France, préc., pt 48).
C’est précisément l’écueil auquel se heurte la pratique en raison de l’effacement du rôle du conseiller de la mise en état.
À l’ouverture des débats devant la cour, après plusieurs années d’attente de fixation, il n’est pas rare en effet que le juge chargé du rapport (ce peut être le conseiller de la mise en état) interpelle les avocats sur la cohérence des conclusions, en ce inclus sur la pertinence des pièces lesquelles sont le soutien indivisible des prétentions. Mais, la clôture ayant été prononcée, l’avocat est démuni pour rectifier quelques imprécisions ou erreurs : procédure écrite oblige ! Celui-ci ne peut que grommeler « pourquoi cette question n’a-t-elle pas été évoquée en mise en état lors de l’instruction du dossier ? ». L’option de renvoyer l’affaire à la mise en état, qui marquerait l’échec cuisant du processus et renverrait à la case départ, enliserait encore plus le rôle déjà fortement embouteillé des cours d’appel. Il en serait de même d’une réouverture des débats avec rabat de l’ordonnance de clôture. Cela explique que les cours d’appel ont tendance à débouter purement et simplement les parties de leurs prétentions…
Au-delà, lorsque le conseiller de la mise en état abandonne le navire, l’iceberg se profile tandis que l’orchestre continue à jouer…
Philippe Gerbay, avoué à la cour honoraire, maître de conférences émérite à la faculté de Dijon