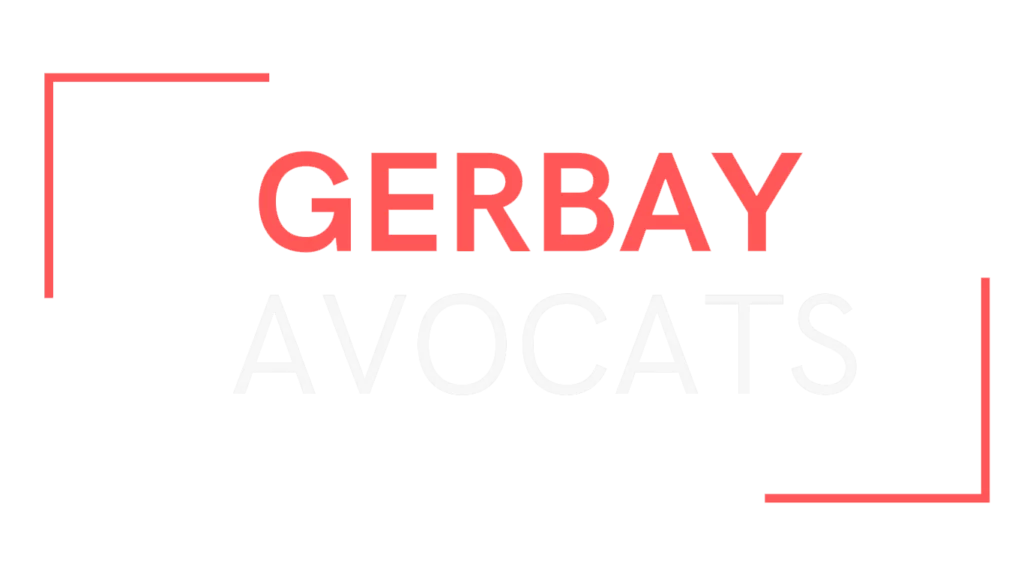Philippe Gerbay, avoué à la cour honoraire, maître de conférences émérite à la faculté de droit de Dijon
Dans les fables de La Fontaine, sur 3 animaux, il y a toujours un intrus…cela s’avère exact en notre matière…
Le jugement qui prononce le divorce statue également sur certaines mesures accessoires (prestation compensatoire, modalités d’exercice de l’autorité parentale, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, usage du nom…). Ce jugement peut faire l’objet d’un appel, lequel peut être « général » ou être « limité » à certaines dispositions. En pratique, l’appelant doit, dans sa déclaration, indiquer les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité (CPC, art. 901). En visant tous les chefs du dispositif du jugement de divorce, l’appel est « général ». Si la déclaration d’appel ne vise que certains d’entre eux, l’appel est « limité ». Par souci de simplicité on se réfère à la notion d’appel « général » ou d’appel « limité ».
Dans l’hypothèse d’un appel, se pose dès lors la question de déterminer à quelle date les époux sont définitivement divorcés. Cela conditionne la fin du devoir de secours (C. civ., art. 270, al.1), la date d’évaluation de la prestation compensatoire, la possibilité de se remarier après transcription à l’état civil. Cette date tient en un mot clé : « force de chose jugée ». L’article 260 du Code civil dispose en effet que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce « à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ». La force de chose jugée est définie à l’article 500 du CPC : « A force de chose jugée, le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai de recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai ».
L’appel du jugement qui prononce le divorce a logiquement un effet suspensif même s’il eut été préférable que le Code de procédure civile l’énonce clairement comme il le fait à propos du pourvoi en cassation (CPC, art. 1086). L’article 1074-1 du CPC se contente d’indiquer que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas exécutoires de droit, sauf celles concernant l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire…).
L’effet suspensif de l’appel du jugement prononçant le divorce est donc tributaire de la portée de l’appel : est-il « général » ou « limité » aux mesures accessoires ? Deux questions à cet égard interpellent. D’une part, il est possible que l’appel « général » englobant le prononcé du divorce soit impossible en l’absence d’intérêt à agir de l’appelant rempli de ses droits en première instance. D’autre part, un appel limité aux mesures accessoires peut être étendu au-delà du délai d’appel au chef du dispositif prononçant le divorce par la grâce du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile. Dans le premier cas, l’appel « général » est paralysé (1), dans le second, il est prorogé (2). Cela influe directement sur la force de chose jugée du jugement prononçant le divorce, ce qui peut être source de combats judiciaires enflammés.
1. La paralysie de l’appel « général »
L’appel « général » du jugement se prononçant sur le divorce et sur les mesures accessoires est inenvisageable si le divorce a été prononcé conformément aux prétentions de l’appelant émises en première instance. Ainsi, en sera-t-il dans le cas du divorce accepté (C. civ., art. 233) ou du divorce aux torts exclusifs de la part de l’époux qui a obtenu entière satisfaction. L’intérêt à agir ne peut résulter du seul intérêt à faire échec à la force de chose jugée du prononcé du divorce afin de faire perdurer le devoir de secours durant l’instance d’appel. Cela résulte clairement d’un avis de la Cour de cassation du 20 avril 2022 : (Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, avis n° 15004, n° 22-70.001 : JurisData n° 2022-006105). Exit la possibilité pour le créancier d’une pension alimentaire de continuer à percevoir celle-ci dans l’attente de l’arrêt de la cour. En l’absence d’appel possible sur le principe du divorce, seule la prestation compensatoire (ou toute autre mesure accessoire) pourra être débattue devant les juges du second degré. Certes, l’ex-époux peut être privé de toutes ressources pendant l’instance d’appel. Pour pallier cette difficulté, l’article 1079 du CPC prévoit que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire. Le texte très logiquement dispose que l’exécution provisoire attachée au versement de la prestation compensatoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis « force de chose jugée ». Une certaine cohérence implique que lorsque le tribunal judiciaire prononce un divorce conforme aux vœux du créancier de la prestation compensatoire, le jugement soit systématiquement assorti de l’exécution provisoire totale ou partielle sur la prestation. Ainsi, il n’y aura pas de hiatus entre la fin du devoir de secours et le versement de la prestation compensatoire.
L’arsenal procédural répond à la problématique posée par la force de chose jugée attachée à la partie du jugement prononçant le divorce, encore faut-il qu’il soit ingénieusement utilisé. Bien sûr, des grains de sable peuvent enrayer le processus : si l’appelant, sciemment (et abusivement !) déclare un appel « général », l’intimé sera contraint de saisir le conseiller de la mise en état (CME) pour faire juger l’irrecevabilité partielle de l’appel (CPC, art. 913-5. – La compétence du CME ne fait aucun doute. L’article 913-5 du CPC, sans autre indication, se réfère à l’irrecevabilité de l’appel. Des réserves ont pourtant été émises sur cette compétence en distinguant l’appel de la procédure d’appel (M. Cadiou et J. Bachelet : AJ famille 2024, p.442)). Le CME se doit d’audiencer l’incident avec célérité et de rendre son ordonnance sans délai. L’appelant pourra profiter de la saisine du CME pour solliciter l’exécution provisoire du jugement si celle-ci n’a pas été ordonnée ; l’article 517-2 du CPC ouvre cette possibilité. À défaut de décision rapide du CME, un bras de fer peut s’engager entre les (ex ?) époux. Le créancier peut s’orienter, faute de règlement, vers une saisie sur salaires. Cela peut provoquer la saisine du juge de l’exécution lequel, pas forcément au fait des questions familiales, héritera du contentieux… Ledit juge peut, de surcroît être confronté à une autre difficulté issue du décret du 29 décembre 2023 bousculant la portée de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
2. Prorogation de l’appel « général »
Selon le nouvel article 915-2 du CPC, l’appelant principal peut désormais compléter dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. En clair, un appel « limité » à la prestation compensatoire peut se transformer en appel « général » incluant le chef du jugement qui prononce le divorce. La cour est saisie par la teneur du dispositif des premières conclusions déposées. Cette disposition laisse pantois au regard de la force de chose jugée du jugement prononçant le divorce. En effet, le mariage a pu être dissous antérieurement au dépôt des premières conclusions de l’appelant. Supposons que l’intimé ait fait signifier le jugement de divorce tout en précisant qu’il acquiesce au prononcé du divorce : À : à l’expiration du délai de recours, le jugement acquiert « force de chose jugée » selon l’article 500, alinéa 2, du CPC. Si l’appel déclaré dans le délai est un appel limité à la prestation compensatoire, on ne voit pas comment l’appelant pourrait faire revivre le mariage postérieurement à l’expiration du délai d’appel dans le cadre de ses premières conclusions. Les conclusions doivent être déposées dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel (CPC, art. 908) mais ce délai peut être allongé par le Conseiller de la mise en état (CPC, art. 911, al. 2), voire interrompu (CPC, art. 915-3). Pourtant, l’appelant peut avoir intérêt à compléter son appel si le divorce n’a pas été prononcé conformément à ses prétentions de première instance (par exemple, le divorce a été prononcé aux torts partagés alors que l’appelant, avait sollicité un divorce aux torts exclusifs). Le dévoiement de l’effet dévolutif de l’appel peut conduire à des situations conflictuelles inextricables. Il aurait fallu, pour le moins, que cette possibilité soit enfermée dans le délai d’appel.
La force de chose jugée, un des piliers de la procédure d’appel, méritait mieux… et ne doit pas être considérée comme un intrus.