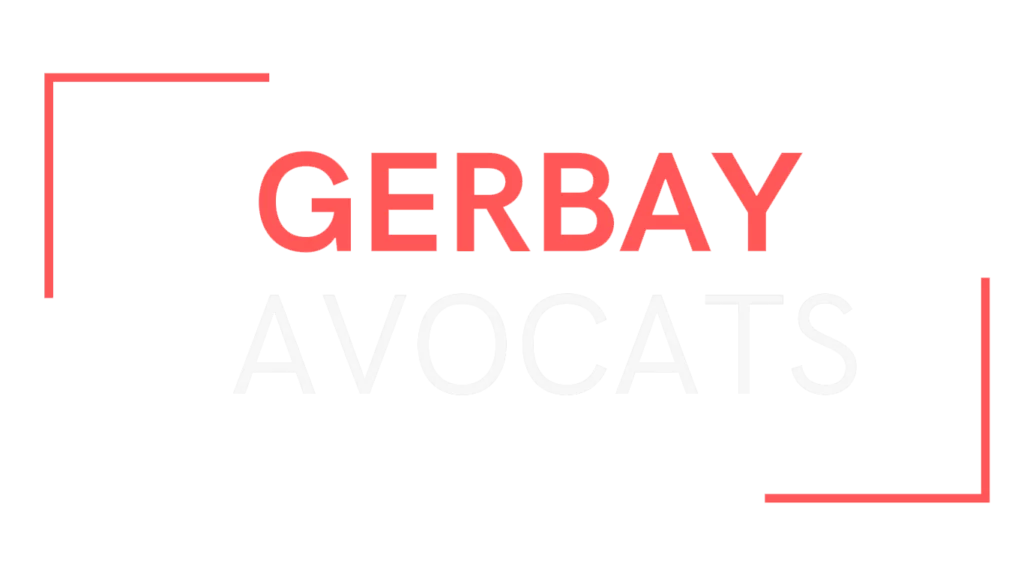Selon la circulaire de présentation du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile : « Après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour conserve le pouvoir de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel et la caducité de la déclaration d’appel » (Circ. n° C3/202430000931, 2 juill. 2024, p. 15).
Cette affirmation ne fait-elle pas fi du décret commenté ? Antérieurement à ce décret, il fallait se reporter à l’article 914, alinéa 6 in fine du Code de procédure civile : « La cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ».Cette disposition suscitait quelques interrogations.
D’abord, cet alinéa était inséré dans une disposition propre aux pouvoirs du conseiller de la mise en état. Fallait-il en conclure que le pouvoir accordé à la cour d’appel était bridé dans le cadre du circuit court (aujourd’hui dénommé procédure à bref délai) ? Rien n’est moins sûr dès lors qu’à l’époque le président de chambre n’était pas « seul compétent » pour statuer sur la caducité (CPC, art. 905-2).
En outre, le texte ne visait que la caducité de l’appel et non son pendant, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé pour non-respect des dispositions des articles 909 et 910 du Code de procédure civile. Pour quelles raisons l’intimé serait-il mieux traité que l’appelant ?
Enfin, mettre sur le même plan fin de non-recevoir et caducité manquait de cohérence. Les fins de non-recevoir sont réglementées dans un chapitre spécifique inséré dans le Livre 1er du Code de procédure civile intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions ». Selon l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent (et non pas peuvent) être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ce qui est le cas, notamment, de l’inobservation des délais dans lesquels doit être exercé l’appel ou si celui-ci n’est pas ouvert. Le décret du 29 décembre 2023 a réorganisé et rationalisé la procédure d’appel. L’ancien article 914 a été dispatché entre l’article 913-5 (compétence du conseiller de la mise en état) et l’article 914-3 (sur la clôture). Il n’est désormais plus fait référence aux pouvoirs d’office de la cour pour relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci. Pour la fin de non-recevoir, cela apparaît non seulement logique mais bienvenu eu égard au libellé de l’article 125 du Code de procédure civile qui sert de référence. En revanche, la nouveauté tient au fait qu’il a été textuellement retiré à la cour le pouvoir de prononcer d’office la caducité. La circulaire, à notre avis, fait revivre une disposition qui a disparu. La caducité de la déclaration d’appel relève désormais de la seule compétence du président de chambre (CPC, art. 906-3) ou du conseiller de la mise en état (CPC, art. 913-5). Ces magistrats peuvent se saisir d’office même si dans la très grande majorité des cas la question est soulevée par l’intimé qui a intérêt à ce que l’appel adverse soit déclaré caduc. Il pourrait, il est vrai, être prétendu que dès son dessaisissement (en général à l’ouverture des débats) la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ou du président de chambre s’éteindrait au profit de la cour. Cette affirmation est à nuancer. Pour l’irrecevabilité de l’appel, en raison de l’article 125 du CPC, la question ne se pose pas. Pour la caducité de l’appel ou l’irrecevabilité des conclusions sur le fondement des articles 906-2, 909, 910 et 911 du CPC, la question se pose en d’autres termes. Il s’agit de sanctions draconiennes destinées à « fluidifier » et accélérer (?) la procédure d’appel… Elles n’ont plus vocation à être contrôlées par la cour lorsque le conseiller de la mise en état ou le président de chambre, dont c’est la fonction, a estimé que l’affaire était en état d’être jugée au fond. Ce retour en arrière serait inapproprié et remettrait en question la cohérence du système.
Cette règle est saine : cela évitera qu’à l’appel des causes la cour fasse trembler les avocats en les interrogeant sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel remontant le plus souvent à quelques années. Une réouverture des débats serait inopérante tandis qu’un renvoi de l’affaire à la mise en état constituerait un détournement de procédure.
Le texte ne pourrait renaître de ses cendres par une quelconque décision prétorienne eu égard, notamment, aux effets draconiens de la caducité. Depuis 2017, le mot caducité rime avec « déchéance de l’appel » (V. CPC, art. 911-1, ancien, al. 2, repris dans CPC, art. 916 nouveau).
Cette nouveauté, hélas, ne s’impose pas immédiatement. En effet, le décret du 29 décembre 2023 ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024 (D. n° 2023-1391, 29 déc. 2023, art. 16). Entre la déclaration d’appel et l’arrêt à intervenir, il y a de (bien) trop longs mois, voire d’années, qui s’écoulent…un piège supplémentaire pour le monde judiciaire.
Philippe Gerbay, avoué à la cour honoraire, maître de conférences émérite à la faculté de droit de Dijon