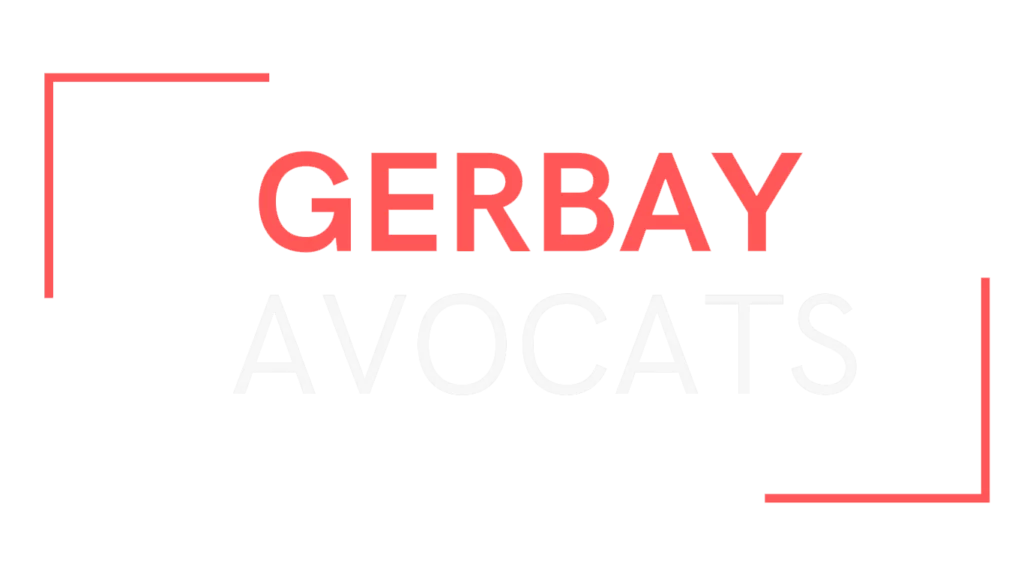Claire Gerbay, avocate au barreau de Dijon, spécialiste en procédure d’appel
Le décret Magicobus modifie le régime procédural de l’appel des ordonnances du JME. Il crée un nouveau piège pour l’avocat qui devra garder à l’esprit d’avoir à inscrire un appel le moment venu. La procédure concernant l’appel différé est par ailleurs soumise à des exigences particulières.
1. Décret Magicobus. Le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, dit Magicobus, a modifié l’article 795 du Code de procédure civile. Désormais, l’appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état (JME) statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance n’est ouvert que lorsque la décision met fin à l’instance. L’appel n’est pas exclu mais il est différé et ne pourra être formé qu’en même temps que l’appel du jugement statuant sur le fond (CPC, art. 795, 2e).
2. Articulation des procédures. L’objectif est d’éviter les recours intermédiaires qui nuisent à la célérité de la justice en ralentissant la procédure. Cependant, cette disposition est piégeuse pour l’avocat. En effet, si, par exemple, une fin de non-recevoir telle que la prescription a été écartée, l’avocat dont le client a été débouté par ordonnance du JME devra être vigilant pour la suite de la procédure :
– Si le jugement du tribunal judiciaire donne raison sur le fond à son client, il faudra se méfier de l’appel de l’adversaire remettant en cause ce jugement. L’intimé doit alors déclarer un appel à l’encontre de l’ordonnance du JME ayant rejeté la fin de non-recevoir s’il estime que celle-ci a des chances de prospérer. À défaut, la cour d’appel ne pourra connaître de la fin de non-recevoir dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
– Si, à l’inverse, le jugement du tribunal judiciaire donne tort au fond à son client, l’appel dirigé contre le jugement devra également l’être contre l’ordonnance du JME (CPC, art. 545). Là encore, à défaut, en l’absence d’effet dévolutif, la cour ne sera pas saisie de la fin de non-recevoir. Dans cette hypothèse, pour être recevable, l’appel de l’ordonnance doit être concomitant de l’appel du jugement sur le fond. Cela implique de former appel par un seul et même acte qui visera les deux décisions ou de former deux actes d’appel datés du même jour (Cass. 2e civ., 5 avr. 2001, n° 99-17613).
3. Rattrapage. Il n’y a pas de solution de rattrapage, sauf à réitérer la déclaration d’appel si les délais ne sont pas expirés. Le piège est d’autant plus grand qu’il peut s’écouler de nombreux mois, voire plusieurs années entre le moment où l’ordonnance du JME a été rendue et celui où la juridiction statue au fond… C’est particulièrement vrai dans les dossiers de construction à multiples parties où la phase d’instruction s’éternise. Qui pourra avoir l’assurance de ne pas oublier en 2030 de faire appel de l’ordonnance qui aura été rendue en 2024, rejetant la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de garantie biennale ou décennale ou du délai de recours entre constructeurs ?
4. Fin de non-recevoir. La solution dégagée par le nouvel article 795 du Code de procédure civile est loin d’être exempte de toute critique. En effet, une expertise est peut-être nécessaire pour déterminer si les travaux relèvent de la garantie décennale ou non. Est-il judicieux dès lors de faire juger au fond des dossiers complexes en première instance pour remettre en cause, des années après la recevabilité même de la demande ? En réalité, s’agissant plus spécifiquement des fins de non-recevoir, leur traitement par le JME, institué par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, aux motifs que la distinction entre fin de non-recevoir et exceptions de procédure était parfois divinatoire, ne semble pas très judicieux.
5. Juge du fond. Il est vrai qu’une échappatoire a été mise en place par le décret Magicobus (CPC, art. 789, al. 9) : le JME peut, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire. Il faut espérer, si un débat sérieux s’engage sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir, qu’il sera largement fait application de cette possibilité. Mais surgira alors un nouveau piège pour l’avocat qui ne devra pas oublier d’intégrer la fin de non-recevoir dans ses conclusions au fond. Les pièges se cumulent : qui oserait prétendre aujourd’hui que la procédure civile est un long fleuve tranquille ?